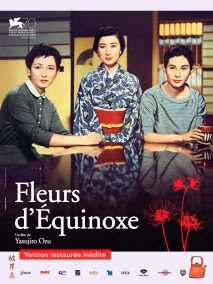Parmi les anti-héros méconnus du cinéma étasunien, Alex Cutter à l'instar de son réalisateur, le tchèque Ivan Passer, fait figure d'oublié. Tiré du film adapté du roman de Newton Thornburg,
Cutter and Bone, renommé quelques temps après sa sortie
Cutter's Way par United Artists (mais n'allons pas trop vite), ce personnage interprété par John Heard
[1] s'inscrit dans les nombreux portraits de marginaux, miroir d'une Amérique en perdition, qui traversèrent le cinéma 70's hollywoodien (
L'épouvantail,
Taxi Driver, etc.). Victime collatérale des déboires financiers et organisationnels du studio créé en 1919, et apparu en sus à l'orée du Reaganisme triomphant, le long métrage non content de connaitre une sortie limitée, reçut sans surprise des critiques mitigées en 1981. Réévalué depuis
[2], ce cinquième film américain de l'ancien scénariste, compatriote et compagnon de route des jeunes années de Milos Forman, est à redécouvrir depuis mercredi en copie restaurée dans les salles obscures.
Une nuit, après avoir quitté l'hôtel El Encantado, et la dame d'un soir venue recevoir les hommages intéressés de ce gigolo en dilettante, et accessoirement vendeur de bateaux de plaisance, Richard Bone (
Jeff Bridges) tombe en panne de voiture dans une ruelle de Santa Barbara. Immobilisé, il croise une voiture qui manque de l'écraser en quittant les lieux à toute vitesse, son conducteur ayant auparavant déposé un mystérieux colis dans une poubelle. Surpris par une averse aussi violente que soudaine, Bone s'échappe sans avoir eu le temps de satisfaire sa curiosité, et part rejoindre son meilleur ami Cutter (
John Heard), un vétéran revenu infirme du Vietnam. Le lendemain, des policiers viennent recueillir sa présence. Il est soupçonné du meurtre et du viol d'une pom-pom girl de 17 ans retrouvée à l'aube à l'endroit où il faillit être renversée. Une fois libéré et lavé de tout soupçon, Bone rejoint Cutter et son épouse Mo (
Lisa Eichhorn) pour la parade espagnole organisée par la communauté hispanique de Santa Barbara. Dans le cortège, il croit reconnaitre le coupable entraperçu la veille, J. J. Cord (
Stephen Elliott), le magnat de la ville. Cutter décide de mener l'enquête...

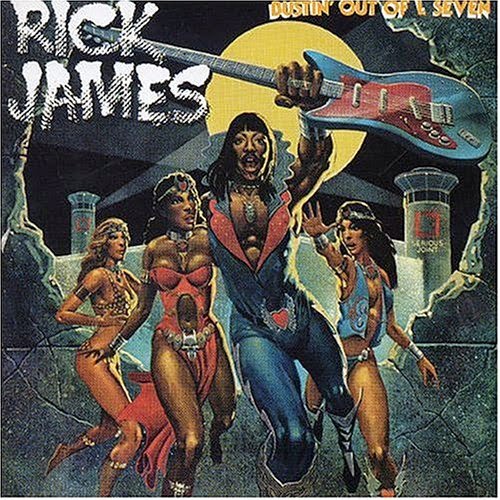













































.jpg)