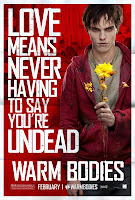Étrangement, il aura fallu attendre plusieurs années au préposé docteur à la chronique avant d'écrire sur le cas
Bruno Mattei. Connu sous le sévère sobriquet d'Ed Wood italien, le cinéaste méritait pourtant qu'on s'y attarde, tant ce dernier s'inscrit dans un cinéma Bis désormais révolu. Capable du pire comme... du pire, le transalpin traîna au cours de sa filmographie, non sans raison, la sévère réputation d'être uniquement un réalisateur de séries Z. A l'instar de son homologue
Joe D'Amato, Mattei signa de ses nombreux pseudonymes (le plus connu étant celui de Vincent Dawn) un panel conséquent de films de genre occupant les salles de quartier de l'époque. Appartenant au cercle des
followers bisseux européens, Mattei suivit méticuleusement le mouvement des modes et succès venus d'outre-Atlantique, pour mieux les copier à sa façon
[1].
Après des débuts de monteur des 60's jusqu'au début des 70's, lui faisant croiser la route de l'espagnol
Jesus Franco pour la version italienne de
L'amour dans les prisons des femmes (99 women) ou bien la fidèle adaptation du roman de Bram Stocker
Les nuits de Dracula, l'homme commença par la suite une carrière de réalisateur en mettant en scène quelques documentaires et
films de
nazisploitation, en attendant son âge d'or la décennie suivante. Le romain réalisa pas moins de onze films entre 1980 et 1984, du zombie miteux au cannibales férocement
cheap, du WIP (avec l'égérie de JDA, la sublime
Laura Gemser) à la
nunsploitation, en passant par le péplum érotique et, le post-nuke et son chef d'œuvre
Les rats de Manhattan. Enfin, passé deux western spaghetti de bonne facture et quelques soubresauts guerriers à la fin des 80's, Mattei se plia dans les 90's à la mode du thriller érotique
[2], avant de revenir au crépuscule de sa vie dans les années 2000 à ses premiers amours gore fauchés.
L'autre enfer sorti en Italie en 1981 contredit d'une certaine mesure cette filmographie rapidement et crapoteusement attachée au dit nanar. Mais n'allons pas trop vite.

.jpg)

.jpg)























+-+Bruno+Mattei.jpg)