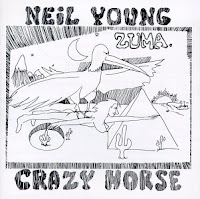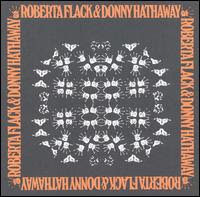Petit avertissement : ce qui va suivre est la stricte vérité (enfin le deuxième paragraphe, pour le reste…), j’en veux pour preuve que j’en suis l’auteur et qu’il s’agit de mon blog (alors hein bon… parfois je suis moi-même ébloui par la maestria de ma rhétorique).
Après une légère pause (plus ou moins) indépendante de ma volonté (qui inclut un passage au Pré St Gervais où en plus de devoir boire une célèbre bière hollandaise (un coup de poignard dans le dos, cela faisait à peine 24h que j’étais en France qu’on me rappelait déjà d’où je venais… mais je n’étais pas à ma première déconvenue…), j’eus (enfin nous eûmes…) l’obligation de subir les premières notes de
Death Magnetic à croire que mon précédent post n’était pas suffisamment clair (quota égocentrique ON)… prouvant que notre hôte sous ses airs débonnaires et hautement sympathiques cachait bien son jeu, l’âme d’un tortionnaire je vous dis (bon ok vous pourriez me rétorquer à juste titre que d’habitude je ne crache pas sur cette qualité humaine… mais quitte à punir le vilain garçon que j’entends être, étonnamment mon hétérosexualité penche pour UNE tortionnaire…), ou seconde option, mon hôte n’était qu’une autre victime de cette soirée, se voyant dans l’obligation de faire plaisir à ses autres invités, une bande de masochistes qui s’ignorent (ceux sont les pires !), implorant silencieusement
Death Magnetic en guise de punition… (et moi au milieu de tout ça !). N’empêche, il serait dommageable de penser que notre hôte allait lâcher le morceau aussi facilement (vous pensiez le contraire, non ?), dès lors ce dernier changea de stratégie et se fit le chantre de la frustration (ce qui, avouons le, était un coup très bas et injuste, puisque le premier (et seul ?) à souffrir de ce plan machiavélique ne fut autre que moi, infliger un tel revers à quelqu’un d’aussi innocent, quelle honte… (bref on appâte le client avec le mot « soubrette »… et pis rien… quitte à noyer mon chagrin en sirotant un mix incroyable à base d’orange, de cactus et de citron vert ?)). Ceci dit, ne nous plaignons pas trop (quoi ? non ce résumé des faits est parfaitement objectif, je ne fais aucunement mon Caliméro), l’auteur de ces lignes n’étant pas atteint d’une acédécéphobie aigue, l’attaque vile des frères Young eut très peu d’effets sur moi (tout le monde ne peut pas en dire autant… néanmoins je n’ai pu constater de filet de bave sur la dite personne, effet secondaire bien connu de cette allergie auditive). Du coup, notre hôte, le cœur sur la main (ouais enfin disons cherchant surtout à se faire pardonner!), proposa à la demoiselle encore sous le choc le choix de la playlist. Et c’était parti pour presque une heure de
Watershed...
Après une introduction toujours aussi à l’ouest (si vous trouvez un quelconque point commun entre cette intro et le reste du post, faites moi signe… moi, j’ai décroché), intéressons nous quelques instants à un groupe qui sur le papier m’avait toujours laissé dubitatif, du fait des futurs errements de son leader, mais pas seulement. En effet, en lisant que Brian May, Roger Taylor et Paul Rodgers nous remettaient le couvert (pourtant il me semble qu’on ne leur avait rien demandé à ces trois là), je me suis souvenu des débuts du groupe du Rodgers, Free. Il serait en effet dommage de réduire cette jeune formation à son tube
All Right Now (certains pourront taxer ce hit d’efficace (c’est l’une des définitions d’un hit me direz vous) mais personnellement, je le considère surtout comme vite soûlant…).
C’est en novembre 1968 qu’apparaît le premier album de Free, une époque où les jeunes britanniques férus de rock’n’roll s’ingéniaient encore à croiser le fer avec le blues. Et c’est vrai que ce disque,
Tons of Sobs, tombe à point nommé, entre un groupe pionnier qui vit ses dernières heures (Cream) et un autre en phase de mutation en passe de devenir prochainement LE groupe (Led Zeppelin).
Cette jeune formation (tous les membres n’ayant pas encore 20 ans lors de l’enregistrement) nous propose ainsi de suivre les traces d’un
Fresh Cream avec toutefois quelques différences notables. Premier point, qui peut paraître trivial ou stéréotypé du fait de leur âge, sur ce premier disque Free donne un rendu plus frais que le premier LP du trio
Bruce/Clapton/Baker (je concède, en 1966, à la sortie de
Fresh Cream, notre trio était loin d’être des vieux brisquards, Ginger Baker, l’aîné, n’atteignant que 26 ans…). Second point, la voix de Paul Rodgers qui du haut de ses 19 ans a de quoi bluffer par sa maturité et ses accents soul (remarquez que par la suite il était de bon ton pour pas mal d’artistes/groupes de blues rock blanc d’être/avoir un chanteur typé soul… Free n’étant peut-être pas les premiers mais soulignant bien ce cas de figure).
Au rayon des nouveautés, l’album s’ouvre et se clôt par le morceau
Over the Green Hills (fait suffisamment rare à l’époque), qui en guise d’introduction tout comme rampe de lancement à l’excellent
Worry joue parfaitement son rôle. On notera aussi la présence de deux reprises blues (étonnant, non ?) dont un
Goin’ Down Slow s’étalant sur plus de 8 minutes. Il convient aussi de souligner le talent certain de la paire Paul Rodgers/Paul Kossoff, le premier étant le principal compositeur du LP, et le second à la guitare étant loin d’être ridicule (18 ans lors de l’enregistrement !). Ensuite forcément on pourra regretter le manque de prise de risque de la plupart des chansons (le canevas est tout sauf aussi aventureux ou tranchant que le
I du quartette Page/Plant/Jones/Bonham par exemple), mais compte tenu de la qualité générale et de l’âge des protagonistes, on ne peut qu’apprécier ce premier album (secondé par la production sobre de Guy Stevens (futur producteur de
London Calling)).
Au final, bien que ce premier album fasse pâle figure comparé aux monstres que sont
Fresh Cream ou le
I de Led Zeppelin,
Tons of Sobs reste néanmoins un LP attachant (contenant le classique
I’m a Mover) et un parfait instantané de la musique blues rock de l’époque (un classique du genre même).