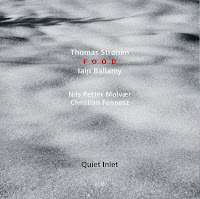Doit-on avouer non sans une certaine gêne que le dernier album des chicagoiens Yakuza, nommé Of Seismic Consequence et sorti en 2010, n'aura laissé que peu de souvenirs au préposé, à tel point qu'il ne sait plus si ce nouvel opus eut droit au moins à une écoute ou non [1]. Un oubli de prime abord quasi injuste tant le souvenir de leur disque Samsara (2006) avait mis en lumière le potentiel de cette formation, mais aussi, par la suite, un anonymat fruit d'un tassement avéré de leur part, les espoirs passés s'étant vite dissipés... Soit le moment propice pour le frontman de Yakuza de publier son premier album solo ?
Doit-on avouer non sans une certaine gêne que le dernier album des chicagoiens Yakuza, nommé Of Seismic Consequence et sorti en 2010, n'aura laissé que peu de souvenirs au préposé, à tel point qu'il ne sait plus si ce nouvel opus eut droit au moins à une écoute ou non [1]. Un oubli de prime abord quasi injuste tant le souvenir de leur disque Samsara (2006) avait mis en lumière le potentiel de cette formation, mais aussi, par la suite, un anonymat fruit d'un tassement avéré de leur part, les espoirs passés s'étant vite dissipés... Soit le moment propice pour le frontman de Yakuza de publier son premier album solo ?Le réflexe premier serait de jouer la carte de la suspicion dès que le chanteur d'un groupe de rock lambda enregistre un album solo [2]. La jurisprudence (et les nombreux exemples qui en découlent) s'accorde en effet à minimiser l'intérêt qualitatif de ces disques, et par conséquent à les ignorer (voire à les railler quand l'anecdotique se mue par exemple en création prétentieuse). Alors s'agissant d'un groupe à consonance métallique, et sa cohorte de clichés lui collant aux basques tel le premier Phtirius inguinalis, peut-on blâmer le préposé ou l'auditeur innocent à remettre en cause son droit à l'information, et à vouloir ignorer tout disque solo provenant de n'importe quel brailleur [3] ?