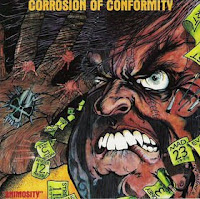En attendant une prochaine chronique musicale à la gloire de la carne en boîte et une autre au bon souvenir du cinéma ultra bis hong-kongais des 80's, voici la critique sans prétention d'un album d'Abstract hip hop qui du reste est lui aussi sans prétention. Liquid hip hop soit le retour d'un bon vieux hip hop old school des familles (2), histoire de faire plaisir aux blogueurs trentenaires et autres quadras (3) nostalgiques du Golden Age.
En attendant une prochaine chronique musicale à la gloire de la carne en boîte et une autre au bon souvenir du cinéma ultra bis hong-kongais des 80's, voici la critique sans prétention d'un album d'Abstract hip hop qui du reste est lui aussi sans prétention. Liquid hip hop soit le retour d'un bon vieux hip hop old school des familles (2), histoire de faire plaisir aux blogueurs trentenaires et autres quadras (3) nostalgiques du Golden Age.En 2002, on avait laissé Laurent Daumail alias DJ Cam avec son album fortement teinté de soul jazz Soulshine qui lui valut un succès mondial avec le single Summer in Paris (à défaut de succès critiques, celles-ci étant plutôt mitigées). Mais Cam l'avait déjà montré par le passé, plus ce dernier s'éloigne de ses racines, plus il a besoin de s'y replonger. En 1998, Cam avait ainsi sorti The Beat Assassinated, le voici donc en 2004 avec Liquid hip hop.